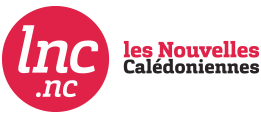- Julien Mazzoni | Crée le 02.04.2025 à 07h00 | Mis à jour le 02.04.2025 à 07h00ImprimerOuvéa est particulièrement concernée par l’érosion du littoral. Ici, le cimetière de la tribu de Mouli, au sud de l’île. Photo archives LNC / Anthony TejeroLa Chambre des comptes vient de publier un rapport où elle passe au crible les politiques publiques mises en œuvre pour faire face aux conséquences du changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Elles sont jugées "insuffisantes et non coordonnées".
Comme tous les États insulaires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie est en première ligne face aux conséquences du changement climatique. En raison de l’élévation du niveau de la mer, supérieure à la moyenne mondiale, 71 % du littoral calédonien est exposé au recul du trait de côte. Sur 33 communes, 31 sont concernées, avec de lourdes conséquences sur les populations, les activités économiques et les infrastructures. Un constat qui nécessite une gestion adaptée et durable de ces risques.
Les institutions ont-elles suffisamment pris la mesure du problème et mettent-elles suffisamment en œuvre des politiques susceptibles de faire face à ce danger ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre la Chambre territoriale des comptes (CTC) dans un rapport rendu public ce lundi 31 mars, qui apporte également des recommandations pour améliorer les actions entreprises par les collectivités.
L’ensemble du territoire exposé à l’érosion côtière
Selon les données fournies par la CTC, en Nouvelle-Calédonie, le recul du trait de côte représente une menace sur les habitations, les infrastructures publiques et privées, notamment les routes et les zones aménagées. L’élévation du niveau de la mer a également des conséquences sur la ressource en eau. La pollution, en particulier par intrusion saline, a un impact sur la consommation d’eau potable, principalement aux Loyauté.
La Chambre note que près de la moitié du littoral de la province Nord est occupée par l’homme, dont 46 % subissent l’érosion. Un accent est également mis sur la ville de Nouméa, en grande partie développée sur du remblai. Elle note qu’entre 1935 et 2016, la part de côtes artificielles est passée de moins de 10 % à plus de 65 %, au détriment de ses espaces naturels. Tout le pays est donc concerné par cette problématique.
L’importance de consolider les données
La Chambre rappelle que "l’acquisition de connaissances sur le recul du trait de côte est essentielle pour cerner la dynamique des systèmes côtiers et identifier les enjeux et leur vulnérabilité". Tout en soulignant le rôle essentiel de l’Observatoire du littoral, créé en 2013, dans le suivi des sites et la production de données, elle recommande que son fonctionnement soit renforcé, pour qu’il puisse remplir pleinement sa mission de collecte et de partage d’informations.
De manière générale, la production de données par les acteurs publics, parapublics et privés mérite davantage de coordination, estime la CTC. Les provinces, en lien avec les communes, sont invitées à effectuer un état des lieux de leur territoire : définir les enjeux, faire un état des lieux des aménagements et de leur impact sur le littoral.
Renforcer la prévention, notamment sur terres coutumières
La Chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de mettre en œuvre des plans de prévention des risques naturels afin de délimiter les zones exposées et définir des prescriptions en matière de construction ou de sécurisation. Pour les instaurer, l’institution suggère la création d’un fonds territorial, qui pourrait s’inspirer du Fonds de prévention des risques naturels (Fonds Barnier) dans l’Hexagone, financé par les contrats multirisques d’habitation. La CTC appuie sur la nécessité de communiquer au niveau communal et coutumier pour sensibiliser les populations aux conséquences de l’élévation du niveau de la mer.
Le rapport invite également le Congrès à consulter les autorités coutumières afin d’adopter une loi du pays "précisant l’incidence des servitudes d’utilité publique sur terres coutumières", qui ne sont soumises à aucune règle d’urbanisme.
Un effort financier insuffisant
L’effort financier annuel déployé par les institutions entre 2019 et 2023 a été estimé à 233 millions pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces Nord et Sud. Le rapport indique que des mesures de protection dans l’urgence peuvent permettre de fixer le trait de côte, mais elles coûtent très cher (digues, murs, cordons de pierres, etc.). Il insiste sur le fait que des solutions fondées sur la nature permettent, à moindre coût, d’agir sur un plus long terme (restauration des mangroves, des herbiers ou des récifs).
Les experts de la CTC mettent également en avant une autre solution, qualifiée de "vivre avec", qui consiste à laisser le littoral s’adapter naturellement à l’érosion. Avec comme conséquence envisageable de déplacer des habitants, ce qui peut en revanche représenter un coût considérable.
Une stratégie à mettre en œuvre concrètement
En septembre 2024, le gouvernement posait sur le bureau du Congrès deux projets de délibération relatifs à la déclaration d’urgence climatique et à la définition d’une stratégie calédonienne du changement climatique. Elles n’ont pas encore été adoptées par le congrès. La Chambre invite donc à préciser les actions menées dans le cadre de ces axes (planification, aménagement, financement, calendrier et la définition de la responsabilité de chaque collectivité) et à mettre en place des indicateurs de réalisation d’impact attendu.
-
-
DANS LA MÊME RUBRIQUE
-
VOS RÉACTIONS




 Les transports aériensà consulter ici
Les transports aériensà consulter ici