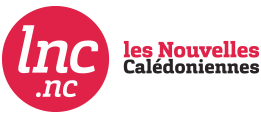- Charlie Réné / Radio 1 Tahiti | Crée le 26.02.2025 à 14h22 | Mis à jour le 26.02.2025 à 16h16ImprimerLe biologiste calédonien Matthieu Juncker a vécu pendant huit mois sur un atoll dans une région reculée de la Polynésie française. Photo Matthieu JunckerFin de la "robinsonnade" scientifique pour Matthieu Juncker, qui a quitté l’atoll des Tuamotu du centre, en Polynésie française, sur lequel il a vécu en autarcie pendant 8 mois. Le biologiste calédonien, qui n’a interrompu son "rêve de gosse" que pour reconnecter avec sa famille à Nouméa au moment des émeutes, a vécu une aventure humaine intense. Il repart avec des dizaines de milliers de données scientifiques, qui décrivent un patrimoine "inestimable", mais menacé par les activités humaines et les changements climatiques. Un récit de notre partenaire Radio 1 Tahiti.
"Je serais bien resté un peu plus, je commençais à être bien." Matthieu Juncker a beau avoir perdu une dizaine de kilos, il affiche son sourire et sa "bonne forme", quelques jours après son retour des Tuamotu du centre. C’est dans cette région de Polynésie française, sur un atoll inhabité dont il préfère taire le nom, qu’il a passé les huit derniers mois. 240 jours d’autarcie au total, que le biologiste calédonien avait prévus, lors de son départ en avril dernier, de mener d’une traite.
Les émeutes de mai 2024 à Nouméa, d’où sa fille et sa femme lui ont envoyé des messages "au milieu des flammes" sur son téléphone satellite, tombé en panne juste après, en ont décidé autrement. Mais après avoir pris "le premier avion" – et quelques bateaux – pour repartir vers le Caillou et avoir passé un peu de temps auprès des siens, il a refait le trajet inverse pour terminer son périple, repoussant ainsi son départ définitif au mois de février.
Cette fois, il est parti pour de bon, et a repris l’avion vers la Nouvelle-Calédonie, mais pas avant d’avoir tiré un premier bilan de son expérience auprès de ses partenaires : l’Office français de la biodiversité, qui a en partie financé ce projet inédit, la Direction de l’environnement de Polynésie française, qui l’a dûment autorisée, et surtout la commune, les gestionnaires et propriétaires fonciers de cet atoll encore très préservé.
Tempêtes, requins, et voileux-dentiste
"Tout ça n’aurait pas pu être possible sans avoir autour de moi ces piliers : les habitants de l’atoll voisin, qui ont pris part au projet, qui m’ont accompagné pour installer mon petit fare ou mes panneaux photovoltaïques, et qui, sans être physiquement présent ensuite, se sont inquiétés pour moi, ont été disponibles quand j’ai dû retourner en Nouvelle-Calédonie, rappelle le biologiste. C’est également eux qui sont les bénéficiaires de ce travail, puisque j’ai des milliers de données qui ont été collectées, un rapport conséquent qui doit sortir, et qui apporte des informations nouvelles pour la science, sur l’état de santé des oiseaux, notamment, mais aussi pour l’atoll. Je leur ai déjà restitué une partie des résultats parce qu’ils sont pour moi le public qui doit être le premier informé, ceux qui gèrent ce lieu, et ceux qui vont permettre par leur implication de préserver l’atoll et les quelques espèces emblématiques qui le peuplent."

Le biologiste calédonien a eu l’occasion d’observer longuement la faune des atolls. Photo Matthieu JunckerLes images paradisiaques qu’il ramène dans ses bagages ne doivent pas faire oublier la réalité d’une expérience en solitaire. Des tempêtes qui mettent en danger le matériel de survie, font "vibrer la barrière" et le font sentir, dans son fare inondé, "comme un fétu de paille" ; des requins qui le "harcèlent" durant ses pêches, des expéditions sur les autres motu, parfois à plusieurs heures de navigation et sans aucune forme d’assistance possible, qui peuvent s’avérer périlleuses ; des petits accrocs de santé qui peuvent avoir de grosses implications sans être soignées…
Matthieu Juncker remercie, par exemple, ce navigateur dentiste retraité, qui au hasard d’une exploration d’atoll, finit par lui "réparer deux dents" dans sa cale. Ou ce chef calédonien, contacté lors de son passage à Nouméa, et qui l’a aidé, grâce à des épices et des techniques de lacto-fermentation, à rompre la monotonie de l’alimentation autarcique.
"Tout était mouvement, tout était dynamique autour de moi"
Il y a aussi, bien sûr, le poids de la solitude, qui, après quelques mois, et dans les périodes de mauvais temps, "mord le ventre" et fait vaciller le moral. Matthieu Juncker a tenu et n’a pas chômé. Entièrement libre de son emploi du temps, il se réveille à deux heures du matin pour aller épier les crabes de cocotier, passe, en journée, de longues heures à observer au téléobjectif les us de familles d’oiseaux. Son trimaran à voile "de poche" lui permet d’aller observer une quarantaine de motu de l’atoll, recenser la présence de rats, d’oiseaux, de marae ou d’autres traces d’activités humaines.
Le paysage est lui en "mouvement permanent" : les déplacements des bancs de sable au gré des coups de vent, la vie qui se déroule chez les visiteurs et habitants de l’îlot – ces fous, titi, ptilopes, sternes et autres gygis dont il a appris les caractères et à qui il a même prêté des noms – les constellations qui disparaissent et apparaissent au gré des saisons…

Le trimaran à voile "de poche" de Matthieu Juncker lui a permis d'aller observer plus en détail des motus des environs. Photo Matthieu JunckerDifficile de "garder des repères" au long terme, explique le Robinson. "Il n’y a rien de plus stable à mon sens qu’un paysage, sauf que ces îlots qui sont à 1m50 au-dessus du niveau de l’eau sont tous les jours quasiment remodelés par la mer, décrit-il. Et puis tu suis un oisillon, un poussin qui a éclos la veille et qui dès le lendemain se tient debout prêt à manger un poisson tendu par ses parents. C’est assez extraordinaire, mais aussi assez perturbant de voir que tout était mouvement, tout était dynamique autour de moi."
Pression sur les oiseaux, le récif, et sur les motu eux-mêmes
Et ce mouvement permanent, il s’agissait justement de l’observer, de le mesurer. Car au-delà du "rêve de gosse", largement réalisé, le biologiste, qui avait quitté son poste à la Communauté du Pacifique pour relever ce défi, s’était fixé des objectifs ambitieux. Il s’agissait notamment de compter et décrire les habitudes des oiseaux marins, comme le très menacé titi, qui n’existe plus que sur quelques motu et dont la population semble, d’après ses observations, avoir été divisée par 3 en 20 ans. Ou de mesurer de l’érosion du rivage et la hauteur de la houle, qui submerge régulièrement les motu lors des tempêtes.
Et même de surveiller la santé du récif tout proche, qui, dès son arrivée, a subi une mortalité de 30 % lors d’un pic de chaleur du lagon. S’ajoutent les relevés d’opportunité, sur la présence de plastiques sur les plages et dans les nids, ou les rencontres de diverses espèces de tortues et de requins. Autant d’observations soigneusement détaillées et compilées qui doivent, pour le biologiste, interpeller sur la fragilité des atolls face aux changements climatiques et aux activités humaines.

Matthieu Juncker a mené de nombreuses observations sur la faune de motus environnant. Photo Matthieu Juncker"Aujourd’hui la récurrence de ces pressions, l’augmentation de ces menaces, qui sont liées à des événements météorologiques extrêmes ou à des pratiques qui vont consister à dévégétaliser, par le feu notamment, et donc à supprimer le couvert végétal qui tient, en quelque sorte, le sable des motu, remet en cause les équilibres fragiles de ces atolls, reprend le scientifique. Et ça peut à un moment basculer. Même si ces atolls sont là depuis des centaines de milliers d’années, voire des dizaines de millions pour le motu où j’ai vécu, on peut très bien imaginer que le ‘drame' arrive, dans un contexte de changements climatiques et de pressions humaines qui s’exercent."
Des généralités scientifiques qui méritent d’être "nuancées"
Autre constat pour le biologiste, qui a participé à plusieurs ouvrages et publications sur la faune marine du Pacifique : les connaissances scientifiques présentées comme "acquises", "fermes", méritent souvent d’être nuancées. "On parle d’une espèce d’oiseau dont l’œuf est censé éclore le matin, mais j’en vois éclore à la tombée de la nuit, du crabe de cocotier qui ne retourne vers la mer que pour pondre, alors que j’observe des mâles aller dans l’eau… Ce sont des éléments qui traduisent que ces grandes généralités sont en partie fausses, et que la complexité de la vie offre tellement de nuances, d’individus, d’autres possibles. Il faut juste être là pour les observer et en témoigner."

En autarcie pendant 240 jours, Matthieu Juncker a dû faire face aux bons comme aux mauvais moments d’une aventure en solitaire. Photo Matthieu JunckerCes 240 jours d’autarcie ne resteront pas qu’un souvenir. Un documentaire sur son périple est en préparation - avec les 300 heures d’images tournées par ses soins ou avec une équipe qui l’a accompagné sur place à l’aller et au départ -, son carnet de bord devrait donner un livre qui intéresse déjà de grands éditeurs, en plus du rapport et des publications scientifiques qui doivent être formalisées dans les prochains mois.
Du côté des Tuamotu, où il a offert à la commune et à ceux qui l’ont aidé l’essentiel de ses équipements, son passage a déjà eu une répercussion. Les propriétaires fonciers de cette île et de l’atoll voisin ont formé une nouvelle association pour prendre ensemble des mesures de protection de la faune et la flore exceptionnelle de leur motu. Lutte contre les rats, meilleure information des copraculteurs, qui débroussent parfois par le feu, ou des visiteurs qui arrivent parfois à la voile avec des chiens… "C’est à eux de prendre les décisions, les actions", note Matthieu Juncker, qui estime, lui, que la sanctuarisation d’une partie de ce patrimoine mérite aussi d’être étudiée.
-
-
DANS LA MÊME RUBRIQUE
-
VOS RÉACTIONS




 Les transports aériensà consulter ici
Les transports aériensà consulter ici