- LNC | Crée le 30.03.2025 à 05h00 | Mis à jour le 30.03.2025 à 05h00ImprimerLe pionnier François-Victor Jarossay en 1873.François-Victor Jarossay est un enfant de troupe. Indiscipliné, l'enfant devenu militaire est condamné par le conseil de guerre puis envoyé à la Nouvelle. Libre et père de famille nombreuse, il finit par vivre une vie simple et laborieuse, comme le feront ses enfants après lui. Serge Jarossay partage avec quelques membres de sa grande famille la passion de la généalogie, et le souhait de mettre en lumière le temps des anciens. Retour sur la vie de François-Victor Jarossay dans ce 45e épisode de notre sage consacrée aux familles issues du bagne.
"Je ne dirais pas comme certains que j'en suis fier, mais j'assume complètement cette réalité. Elle fait partie de mon histoire et il est temps aujourd'hui que la vérité soit connue, il n'y a pas de honte à avoir. "

Serge à l'entrée du village.Serge Jarossay s'exprime clairement et posément à la manière de ceux qui cherchent méticuleusement. Il a 60 ans quand il apprend, en 1994, le passé bagnard de son arrière-grand-père. Son neveu, Eric, est alors étudiant à Aix-en-Provence et passe ses journées aux Archives de l'outre-mer.
Son cousin, un autre Eric, savait lui, mais respectait le silence imposé. Toutes ces dernières années ont été employées à éclairer le passé et à partager l'histoire recouvrée.
Un militaire hors du rang
" La famille de notre ancêtre est issue d'un hameau d'Indre-et-Loire qui porte son nom, " Les Jarossais ". François-Victor a deux frères cadets, Émile et Gaston, dit Camille.

Le pionnier François-Victor Jarossay en 1873.Fils de gendarme, il sait écrire, lire et compter et rejoint le 106° régiment d'infanterie comme enfant de troupe puis choisit à 17 ans d'intégrer l'armée. Il s'engage au 2° régiment des chasseurs d'Afrique où il signe pour cinq ans le 12 mars 1874. Il devient chasseur de deuxième classe, suit l'école du peloton et celle de l'escadre.
Il est visiblement très indiscipliné et enchaîne les motifs de punitions
Il est visiblement très indiscipliné et enchaîne les motifs de punitions tels "écrit une lettre au capitaine-instructeur en imitant la signature du colonel. Manque à l'appel et au pansage du matin. Manque à la théorie, perd son sac, quitte son poste de planton à la porte du cercle en prétendant en avoir reçu l'ordre du colonel ". Le 2 janvier 1875, le conseil de guerre d'Oran finit par le condamner à cinq ans de travaux forcés, assortis de dix ans de surveillance, avec dégradation militaire. Notre arrière-grand-père est reconnu coupable de faux en écriture authentique et publique, en écriture privée, vol et abus de confiance au préjudice de militaires.
Ceci pour avoir manqué à l'appel pendant trente-six heures et cherché, à l'aide de fausses pièces, à s'embarquer pour la France. Il échappe à la condamnation pour désertion.
Il est envoyé au dépôt de Saint-Martin-de-Ré puis expédié au bagne de Nouvelle-Calédonie par l'Orne où il arrive le 22 septembre 1875.
Une nouvelle branche
" Il y a finalement peu de choses dans son dossier, comparativement aux autres. " Et des dossiers, Eric Jarossay, le neveu de Serge, en a consulté une multitude. " Pendant mes études à Aix-en-Provence dans les années 80, je suis devenu le correspondant du Cercle généalogique de la Nouvelle-Calédonie. Je passais des journées entières aux archives. J'ai ouvert des cartons qui, pour certains, ne l'avaient pas été depuis des décennies. J'ai cherché notre histoire puis celle de nombreuses familles calédoniennes, et ce que j'ai trouvé ne faisait parfois pas plaisir.

Serge Jarossay entouré des deux Eric Jarossay.Il est parfois difficile d'apprendre que son aïeul a commis un crime. C'est à ce moment-là que je découvre qu'un certain François Jarossay fait partie des condamnés à la Nouvelle. Ce patronyme est peu répandu et donc le lien avec notre famille rapidement fait. Quelle émotion !
Dans le dossier de François-Victor il n'y a pas de photos et peu d'éléments.
Cette découverte mettait au jour un passé encore inconnu de la plupart d'entre nous. Dans le dossier de François-Victor il n'y a pas de photos et peu d'éléments. Il a donc fallu chercher ailleurs, aux archives militaires, puis aux archives paroissiales de son village natal. " En 2006, Serge et son épouse Rosemonde font le déplacement en Indre-et-Loire. " Nous avons appris que le dernier frère de notre ancêtre, Gaston dit Camille, et son épouse étaient les derniers à avoir habité Neuvy-Le-Roi.

Place de la mairie de Neuvy-le-Roi." Aucun contact n'a été gardé avec la famille métropolitaine. Les Jarossay de Calédonie ne se sentent pas vraiment de lien de parenté avec eux, " en Calédonie une nouvelle branche est née, une nouvelle histoire s'est écrite ".
Liberté surveillée
François-Victor est libéré le 6 janvier 1880 en 1re section, c'est-à-dire qu'il est libre mais encore tenu de rester cinq ans en Nouvelle-Calédonie. Tous les bagnards condamnés à plus de huit ans devaient rester sur le Caillou, tandis que ceux pour qui la condamnation était inférieure devaient faire un temps égal à leur peine sur la colonie avant d'atteindre la 2° section et voir levée leur astreinte à résidence.

Alphonsine Bourbon (l'épouse du pionnier) et ses six enfants: Alphonse et Paul, Célénie, Camille (appelée Blanche), Victorine et Mathilde.En 1883, à Bourail, il épouse Alphonsine Bourbon, également fille de transporté. De leur union vont naître sept enfants: Alphonse et Paul et leurs sœurs, les futures Mmes Célénie Cureau, Camille Wannisberghe, Victorine Foot, Mathilde Papavoine. Eugène, leur troisième fils, est décédé en bas âge. Le 17 juin 1886, alors qu'il pouvait retourner en France avec femme et enfants, François-Victor reste en Nouvelle-Calédonie et est mis en concession provisoire sur un lot rural à Bourail dont il devient propriétaire cinq ans plus tard. Or en 1891, la famille quitte la campagne et s'installe rue de Sébastopol à Nouméa. Mon arrière-grand-père devient stockman puis officier mécanicien à bord du Fiado. Ce petit cargo fait la navette entre Nouméa et Sydney en transportant charbon et bétail, et parfois il fait aussi le tour de côte. François-Victor décède le 20 juin 1897 d'un abcès au foie, à 41 ans.
La terre après la guerre
" Devenue veuve à 31 ans, avec six enfants à charge, Alphonsine exerce le métier de blanchisseuse à son domicile. Elle décède à Nouméa en 1903.

Alphonse et Paul Jarossay en 1916.Alphonse et Paul deviennent bouchers. Mon grand-père, Alphonse, exerce à la quarantaine de Ducos, puis tous les deux partent au front. Mon grand-oncle Paul en revient blessé à la main, et se marie avec Henriette Guillonneau avec qui il a dix enfants. La famille s'installe rue Taragnat et élève du bétail. Henri, leur fils aîné, arrête tôt l'école et aide ses parents. Les journées sont rudes.
À son retour Alphonse divorce de Françoise Leudière dont il avait légitimé le fils, Alexandre, avant son départ. Avec sa seconde femme, il s'installe à la Vallée-des-Colons puis déménage pour Yahoué en 1926 où ils élèvent des vaches laitières et un petit troupeau de bétail.

Blanche (Camille) Jarossay, son époux Charles Wannisberghe et sa fille Hélène.Alexandre épouse Hélène Poncelet en 1928. Ensemble ils ont neuf enfants. Mon père travaille à la SLN comme mécanicien. Pendant la crise des années 30, il fait partie des travailleurs au chômage technique envoyés " taper dans la butte ". Par la suite, toujours pour la SLN, il embarque sur les navires de la société comme second mécanicien pour le transport du charbon de Newcastle.
Aujourd'hui, les descendants du pionnier sont nombreux, environ 400 sur six générations et alliés à de multiples grandes familles calédoniennes, quelle que soit leur origine. C'est un détail qui ne compte plus désormais. "
Les chômeurs tapent dans la butte

Baie de la Moselle circa 1912. La rue lingeant la mer a l’époque, avant les grands chantiers de remblai, est la rue Sébastopol.Depuis la fin du XIXème siècle, une politique de grands travaux de remblayage est menée. Petit à petit, Nouméa se construit en gagnant sur la mer. De 1931 à 1936, l'aménagement de la baie de la Moselle se développe pour pallier un chômage important dû à la crise des années 30, qui touche notamment les employés du Nickel. La terre de remblai est alors apportée des collines de l'Artillerie et du Mont-Coffyn. Mais ce chantier, véritable travail de forçat accompli par des " libres ", suscite à l'époque, selon la tradition orale, bien des mécontentements et une vague de ressentiment à l'égard des travailleurs étrangers. En l'absence de syndicats pour les défendre, les ouvriers du Nickel se retrouvent sans emploi et occupés donc à " taper dans la butte " tandis que les engagés javanais, tonkinois..., " protégés " par leur contrat d'engagement, conservent leurs emplois, très mal rémunérés certes, mais des emplois tout de même !
Note
Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l'Association témoignage d'un passé.
Cet article est paru dans le journal du samedi 6 août 2016.
Quelques exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.
-
-
DANS LA MÊME RUBRIQUE
-
VOS RÉACTIONS




 Les transports aériensà consulter ici
Les transports aériensà consulter ici






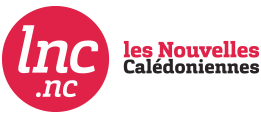
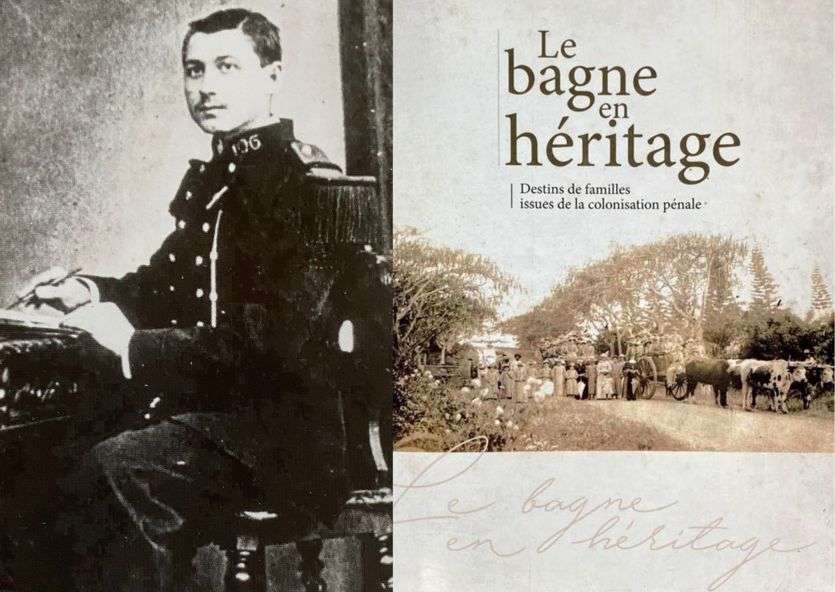
![[SÉRIE] Famille Havet : surveillant à la fin du bagne](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309384/0ad29fc68cd76edd2a1e29v_00132589.jpg?itok=p8PAAJz8)
![[SÉRIE] Famille Guépy : Une longue lignée du sud au nord de la Grande Terre](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309321/7d93a7e393d7651a325a3av_00132521.jpg?itok=FaWh6G82)
![[SÉRIE] Famille Grimm : entre Cayenne et l'île Nou, le périple du surveillant militaire Jean-Baptiste Grimm](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309039/eb99547504b76bf9983a95v_00132092.jpg?itok=zG54Effa)
![[SÉRIE] Famille Grimigni : Innocent Grimigni, le bagne comme salut](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309036/6f3d6f7104b76334df64d6v_00132084.jpg?itok=JRG1MezJ)