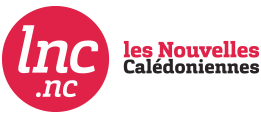- Propos recueillis par Julien Mazzoni | Crée le 28.03.2025 à 10h00 | Mis à jour le 28.03.2025 à 10h12ImprimerBenoît Trépied est anthropologue au CNRS. Photos DRBenoît Trépied est anthropologue au CNRS, spécialiste du Pacifique. Il vient de publier un ouvrage intitulé Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, dans lequel il pose un regard dépassionné sur les événements qui ont secoué le pays depuis le 13 mai 2024. Entretien.
Vous venez de publier un essai intitulé Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Quel est l’objet de cet ouvrage ?
J’ai décidé d’écrire ce livre après l’explosion de violence qui a touché Nouméa en mai-juin 2024. Il m’a semblé urgent de replacer ces événements dramatiques dans une perspective historique plus large pour mieux les comprendre. Faire un détour par l’histoire et les sciences sociales pour penser le présent, c’est un moyen de prendre du recul face à la sidération, de calmer les ardeurs et les passions au profit de la réflexion et de l’esprit critique. L’objet principal de l’ouvrage, c’est donc d’examiner les multiples causes, inscrites dans le temps long, qui ont mené au 13 mai.
Vous êtes chercheur au CNRS, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée ?
Au cours des dernières décennies, de nombreuses recherches scientifiques de grande qualité ont été menées dans le pays, dont beaucoup ne sont guère connues du grand public. Elles fournissent pourtant des éclairages indispensables pour comprendre les racines du contentieux colonial calédonien et ses multiples transformations jusqu’à nos jours. C’est pourquoi le livre offre une synthèse générale de cette vaste littérature scientifique, dans une langue accessible à tous. Je m’appuie aussi sur mes propres enquêtes de terrain et dans les archives menées depuis vingt-cinq ans sur le Caillou, et plus largement sur les nombreux liens intellectuels et affectifs qui, depuis tout ce temps, "m’attachent" au pays, à sa complexité et à ses habitants.
Quel regard portez-vous en tant que chercheur sur les événements qui ont secoué le pays à partir du 13 mai 2024, comment les qualifier ?
Le choix des mots s’avère difficile puisqu’il n’y a pas de consensus : certains parlent d’exactions, d’actes délinquants ou d’émeutes, d’autres de révolte ou d’insurrection, ce qui n’a pas du tout la même signification. A minima, je pense qu’on a assisté à un soulèvement à la fois politique et social. Politique, car la question du corps électoral a mis le feu aux poudres. Mais aussi social, car l’explosion urbaine s’est nourrie d’inégalités sociales et de discriminations raciales qui sont des héritages de la colonisation, d’une époque où les mécanismes d’exclusion et de marginalisation des Kanak étaient au fondement de la société. Il nous faudra encore beaucoup de temps pour saisir réellement ce qui s’est passé, ce qui s’est joué, à partir du 13 mai.
Le pari de la décolonisation lancé par l'accord de Nouméa, celui d'une réconciliation entre les anciens colons et les anciens colonisés dans une citoyenneté inclusive et une émancipation partagée, demeure un pari audacieux et précieux
C’est le dégel du corps électoral qui a mis le feu aux poudres l’an dernier. Dans votre ouvrage, vous évoquez l’importance de travailler sur la construction d’un code de citoyenneté calédonienne. Autour de quelles valeurs pourrait-il s’articuler selon vous ?
Si la question du corps électoral est si sensible, c’est parce qu’au-delà de la seule problématique électorale, elle fixe les frontières de la citoyenneté calédonienne. Le corps électoral définit le périmètre des personnes qui reconnaissent le Caillou comme leur pays, qui sont d’ici et pas d’ailleurs, et qui tentent ensemble de dépasser leurs anciens antagonismes hérités de la colonisation dans un projet d’émancipation partagée. Pendant l’accord de Nouméa, ce peuple calédonien en devenir était celui qui votait aux provinciales. Il excluait les personnes arrivées dans le pays après 1998, c’est-à-dire après le début officiel du processus de décolonisation. Maintenant que l’accord est terminé, il faut rouvrir le dossier et inventer un véritable code la citoyenneté. Mais sans jamais oublier que les Kanak ont été historiquement rendus minoritaires sur leur propre terre par la colonisation de peuplement, "étrangers dans leur propre pays" disait Jean-Marie Tjibaou. Et qu’il est donc compliqué, pour eux, d’accueillir encore de nouveaux venus dans le corps des citoyens, alors même que le peuple kanak refuse simultanément d’être invisibilisé ou noyé dans le peuple calédonien – a fortiori dans le peuple français. Plutôt que de miser sur un passage en force, il faut privilégier la nuance et la subtilité.
Vous critiquez également les trois partenaires de l’accord de Nouméa (État, loyalistes et indépendantistes). L’ADN a-t-il selon vous échoué ?
Le pari de la décolonisation lancé par l’accord de Nouméa, celui d’une réconciliation entre les anciens colons et les anciens colonisés dans une citoyenneté inclusive et une émancipation partagée, demeure un pari audacieux et précieux. En revanche la mise en œuvre de l’accord n’a pas été à la hauteur du souffle de 1998. Côté loyaliste, certains ont clairement renié la signature de Jacques Lafleur et du RPCR de l’époque. Côté État, le processus de décolonisation a été sacrifié à l’autel de la stratégie " indo-pacifique " de la France entre 2021 et 2024. Enfin côté indépendantiste, beaucoup ont jugé qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner d’une remise en cause trop frontale du processus institutionnel en cours, en dépit des dérives avérées des autres signataires.
"Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie", ça veut dire quoi finalement ?
À court terme, ça veut dire mettre un terme à la réponse essentiellement répressive et punitive de certains responsables loyalistes et de l’État vis-à-vis des Kanak et des Océaniens du Grand Nouméa. Cette attitude revancharde ne peut mener qu’à la catastrophe. À plus long terme, le pays explosera de nouveau si aucune réponse politique et sociale n’est apportée à la revendication kanak de souveraineté et d’indépendance, toujours aussi vive, même et surtout chez les jeunes. C’est non seulement la leçon du 13 mai, mais c’est aussi le sens de l’histoire : des 18 000 voix de retard des indépendantistes au référendum de 2018, on est passé à 10 000 voix d’avance aux législatives de 2024. Songeons aussi à ce qu’il se passe en dehors du Grand Nouméa, de VKP à Bourail, de Koumac à Poindimié et ailleurs, là où Kanak et Caldoches ont fait la paix au nom de leur commune appartenance au pays. Il suffit de suivre l’exemple de la brousse : la décolonisation de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie est là, à portée de main.
-
-
DANS LA MÊME RUBRIQUE
-
VOS RÉACTIONS




 Les transports aériensà consulter ici
Les transports aériensà consulter ici